Comment expliquer les mutineries dans l'armée française en 1917 ?
Choses à Savoir HISTOIRE - Un pódcast de Choses à Savoir
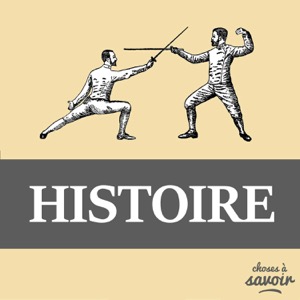
Categorías:
Au printemps 1917, l’armée française traverse l’une des plus graves crises de son histoire : des dizaines de milliers de soldats se mutinent, refusant de monter au front. Contrairement à une idée reçue, ces hommes ne se rebellent pas pour fuir le combat, mais pour protester contre des conditions de guerre devenues insupportables.Tout commence avec l’offensive du Chemin des Dames, lancée en avril 1917 par le général Nivelle. Elle devait être décisive, briser les lignes allemandes et mettre fin à l’impasse de la guerre de tranchées. Mais c’est un échec sanglant : plus de 130 000 soldats français sont tués ou blessés en quelques jours, pour un gain territorial minime. Les tranchées sont remplies de boue, de cadavres, et les soldats, surnommés les "poilus", en sortent brisés physiquement et moralement.Mais la colère couvait déjà. Depuis 1914, les soldats vivent l’horreur au quotidien : bombardements incessants, attaques à la baïonnette, gaz toxiques, conditions sanitaires déplorables. À cela s’ajoute le fossé entre le front et l’arrière : pendant que les poilus risquent leur vie, l’arrière semble reprendre une vie normale, et certains enrichis par la guerre paraissent indifférents à leur sort. Le moral s’effondre.Les premières mutineries éclatent en mai 1917. Au total, elles toucheront près de 40 divisions sur les 110 que compte l’armée française. Des soldats refusent de retourner au front, chantent des chansons antimilitaristes, réclament des permissions, et parfois, hurlent : "À bas la guerre !". Mais ils ne désertent pas massivement : ils restent dans les casernes, dans les cantonnements, prêts à défendre leur patrie... mais plus à mourir pour des offensives absurdes.Face à cette crise, l’état-major réagit avec fermeté mais aussi intelligence. Le général Pétain, qui remplace Nivelle en mai 1917, comprend qu’il faut restaurer la confiance. Il renonce aux offensives inutiles, améliore l’approvisionnement, allonge les permissions, renforce les soins médicaux. Il prend aussi des mesures répressives : 554 condamnations à mort sont prononcées, mais seules 49 exécutions auront effectivement lieu.Ces mutineries resteront longtemps un sujet tabou, perçues comme une tache sur l’honneur militaire. Pourtant, elles expriment avant tout un ras-le-bol collectif face à l’inhumanité d’une guerre d’usure, et un désir de vivre, pas de trahir.En somme, les mutineries de 1917 ne furent pas une rébellion contre la France, mais un cri désespéré de soldats à bout, épuisés par des années d’une guerre devenue absurde. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
